
Dans le célèbre roman d’Umberto Eco, le « nom de la Rose », les frères disparaissaient mystérieusement, ici au couvent des dominicains de la rue Edmond Rostand (appelé aussi couvent de Saint Lazare), et c’est assez rare pour le souligner, ils ont plutôt tendance à chercher la lumière et le partage avec le public. Mais pourquoi cette évocation de la rose ? Cet emblème exclusif de la Vierge est ici omniprésent dans l’architecture audacieuse de Pierre Bossan à qui l’on doit notamment, jusqu’à son décès, le début de la construction de la Basilique Notre-Dame de Fourvière à Lyon.
 Au sein de l’édifice et de son cloitre, on retrouve la fleur partout, en couleur sur les murs, en vitraux, en sculptures et dans les piliers orientalistes soutenant sa structure très atypique. Autre détail surprenant, la présence très marquée du chien, symbole de l’ordre des dominicains. Il se niche avec sa torche, avec laquelle il embrase le monde, sur de très nombreuses œuvres de l’édifice qui abrite l’une des rares représentations en son chœur de Saint-Dominique, saint-patron des Dominicains, qui reçoit son rosaire de la Vierge donnant ainsi naissance à la “prière du chapelet”. Le lieu est aussi chargé d’histoire…D’abord établi à la périphérie de la ville en 1225, hors de son enceinte, sur un terrain situé entre les actuelles rues Saint-Férréol et de Rome, le premier couvent fut détruit en 1524 lors du siège de Charles de Bourbon. En effet, pour protéger la cité et en favoriser sa défense, il fut décidé de raser les faubourgs et ainsi de déloger Prêcheurs et Mineurs qui y avaient établis leurs couvents respectifs.
Au sein de l’édifice et de son cloitre, on retrouve la fleur partout, en couleur sur les murs, en vitraux, en sculptures et dans les piliers orientalistes soutenant sa structure très atypique. Autre détail surprenant, la présence très marquée du chien, symbole de l’ordre des dominicains. Il se niche avec sa torche, avec laquelle il embrase le monde, sur de très nombreuses œuvres de l’édifice qui abrite l’une des rares représentations en son chœur de Saint-Dominique, saint-patron des Dominicains, qui reçoit son rosaire de la Vierge donnant ainsi naissance à la “prière du chapelet”. Le lieu est aussi chargé d’histoire…D’abord établi à la périphérie de la ville en 1225, hors de son enceinte, sur un terrain situé entre les actuelles rues Saint-Férréol et de Rome, le premier couvent fut détruit en 1524 lors du siège de Charles de Bourbon. En effet, pour protéger la cité et en favoriser sa défense, il fut décidé de raser les faubourgs et ainsi de déloger Prêcheurs et Mineurs qui y avaient établis leurs couvents respectifs.
 Obligés de se réfugier à l’intérieur des murailles de la ville, les frères acquirent un ensemble de terrains, sur lesquels ils vont construire petit à petit, au gré des dons, leur nouvelle église et des bâtiments conventuels. De cette seconde implantation, qui devait durer jusqu’en 1794, la Révolution favorisant la dissolution de la communauté, il reste la belle église conventuelle devenue depuis 1802 la paroisse Saint-Cannat, dont on peut apercevoir la façade depuis la rue de la République. Puis le site fut restauré ici en 1878 grâce au mécénat d’Anne-Rosine Noilly-Prat, héritière de la célèbre usine de vermouth voisine, dont les lettres « NP » apparaissent sur une façade par les fenêtres du couvent. Il est également étonnant de retrouver sur des portes en bois de l’église le cachet et les scellés de l’expulsion des moines résultant des lois de 1905…ils ne purent réintégrer les lieux qu’en 1921.
Obligés de se réfugier à l’intérieur des murailles de la ville, les frères acquirent un ensemble de terrains, sur lesquels ils vont construire petit à petit, au gré des dons, leur nouvelle église et des bâtiments conventuels. De cette seconde implantation, qui devait durer jusqu’en 1794, la Révolution favorisant la dissolution de la communauté, il reste la belle église conventuelle devenue depuis 1802 la paroisse Saint-Cannat, dont on peut apercevoir la façade depuis la rue de la République. Puis le site fut restauré ici en 1878 grâce au mécénat d’Anne-Rosine Noilly-Prat, héritière de la célèbre usine de vermouth voisine, dont les lettres « NP » apparaissent sur une façade par les fenêtres du couvent. Il est également étonnant de retrouver sur des portes en bois de l’église le cachet et les scellés de l’expulsion des moines résultant des lois de 1905…ils ne purent réintégrer les lieux qu’en 1921.
 Peut-être que l’un des frères vous montrera la minuscule salle de la chaudière, en sous-sol, qui servit de cachette aux Juifs persécutés de 1940 à 1942 et de centre de diffusion des Cahiers du Témoignage chrétien. Simone Weil y participa. Elle eut ici de nombreuses conversations théologiques avec le père Perrin. Aujourd’hui le lieu affiche donc une véritable volonté de s’ouvrir à tous grâce à son foyer étudiant, sa riche bibliothèque comprenant 30 000 livres sur 1 600 mètres de rayonnage, son centre Cormier de 160 places et ses nombreuses activités intellectuelles, culturelles et spirituelles, et bien sûr par la visite libre de sa très intéressante église florale. Le couvent a pu être en 2010 en grande partie rénové et réhabilité, après 6 années de travaux et 6 millions de travaux, grâce à la générosité de donateurs et à l’aide des élus de la Région, du Département et de la Ville. Le couvent organise également chaque année des sessions de révision pour 15 candidats bacheliers désireux de se consacrer entièrement à leurs révisions dans le cadre très calme des lieux et de son jardin intérieur.
Peut-être que l’un des frères vous montrera la minuscule salle de la chaudière, en sous-sol, qui servit de cachette aux Juifs persécutés de 1940 à 1942 et de centre de diffusion des Cahiers du Témoignage chrétien. Simone Weil y participa. Elle eut ici de nombreuses conversations théologiques avec le père Perrin. Aujourd’hui le lieu affiche donc une véritable volonté de s’ouvrir à tous grâce à son foyer étudiant, sa riche bibliothèque comprenant 30 000 livres sur 1 600 mètres de rayonnage, son centre Cormier de 160 places et ses nombreuses activités intellectuelles, culturelles et spirituelles, et bien sûr par la visite libre de sa très intéressante église florale. Le couvent a pu être en 2010 en grande partie rénové et réhabilité, après 6 années de travaux et 6 millions de travaux, grâce à la générosité de donateurs et à l’aide des élus de la Région, du Département et de la Ville. Le couvent organise également chaque année des sessions de révision pour 15 candidats bacheliers désireux de se consacrer entièrement à leurs révisions dans le cadre très calme des lieux et de son jardin intérieur.
En 2024, l’édifice connaît sa première restauration en près de 150 ans grâce à un appel aux dons, cependant l’usage d’un laser pour nettoyer les peintures et la nécessité d’étaler les travaux dans le temps font exploser le budget, chiffré à près de 10 millions d’euros.
Pierre Bossan, architecte
 Il est né à Lyon en 1814, au sein d’une famille modeste. Ainé de sept enfants, il peut effectuer des études et s’oriente vers l’architecture. D’abord à l’école des Beaux-Arts de Lyon, il rejoint l’atelier de Labrouste à Paris. De retour à Lyon à 25 ans, il est plein d’ambition et espère faire fortune rapidement. Il obtient la fonction d’« architecte de la cathédrale » et se voit confier la réalisation d’une église neuve pour remplacer l’église de la commanderie du temple qui croule : c’est Saint-Georges qu’il bâtit en 1845, dans un style gothique très pur. Il la traitera « d’erreur de jeunesse », or si elle ne porte pas la marque de l’artiste, elle est une réussite néogothique. C’est une période prolifique : l’église de Tassin, la chapelle des jésuites, rue Sala, la chaire épiscopale en bois à la cathédrale, etc. Il part en voyage en Italie en 1845. Lors de son passage en Sicile il découvre l’art byzantin. Il est conquis. Pendant son voyage, son frère qui l’avait accompagné meurt. L’architecte est très troublé.
Il est né à Lyon en 1814, au sein d’une famille modeste. Ainé de sept enfants, il peut effectuer des études et s’oriente vers l’architecture. D’abord à l’école des Beaux-Arts de Lyon, il rejoint l’atelier de Labrouste à Paris. De retour à Lyon à 25 ans, il est plein d’ambition et espère faire fortune rapidement. Il obtient la fonction d’« architecte de la cathédrale » et se voit confier la réalisation d’une église neuve pour remplacer l’église de la commanderie du temple qui croule : c’est Saint-Georges qu’il bâtit en 1845, dans un style gothique très pur. Il la traitera « d’erreur de jeunesse », or si elle ne porte pas la marque de l’artiste, elle est une réussite néogothique. C’est une période prolifique : l’église de Tassin, la chapelle des jésuites, rue Sala, la chaire épiscopale en bois à la cathédrale, etc. Il part en voyage en Italie en 1845. Lors de son passage en Sicile il découvre l’art byzantin. Il est conquis. Pendant son voyage, son frère qui l’avait accompagné meurt. L’architecte est très troublé.
 Alors libre-penseur, Bossan, à son retour d’Italie, va visiter Ars en 1852, en compagnie de sa sœur Thérèse. Il y rencontre le curé, Jean-Marie Vianney, et se convertit. De son côté, sa sœur entre dans les ordres. S’il n’est plus architecte de la cathédrale depuis 1847, les commandes s’enchaînent : son style prend un tour très personnel et très néo-byzantin. Il est déjà en train de dessiner des plans pour une « grande église » sur la colline de Fourvière. En 1850, il est à Rome, et il obtient le grand prix de Rome d’architecture. C’est là que son projet de Fourvière prend forme. À partir de 1852, il bâtit de nombreuses églises, chapelles et maison particulière. Il dessine aussi toute sorte de statues, de mobilier, d’orfèvreries. Lorsqu’en 1871 est prise la décision de bâtir la basilique Notre-Dame de Fourvière, à la suite de la préservation de la ville de Lyon de l’invasion prussienne, Bossan est fort de ses réalisations en particulier les sites de pèlerinage d’Ars (église Sainte-Philomène, début de construction en 1862) et de Lalouvesc (début de construction en 1864, ouverture au public en 1871).
Alors libre-penseur, Bossan, à son retour d’Italie, va visiter Ars en 1852, en compagnie de sa sœur Thérèse. Il y rencontre le curé, Jean-Marie Vianney, et se convertit. De son côté, sa sœur entre dans les ordres. S’il n’est plus architecte de la cathédrale depuis 1847, les commandes s’enchaînent : son style prend un tour très personnel et très néo-byzantin. Il est déjà en train de dessiner des plans pour une « grande église » sur la colline de Fourvière. En 1850, il est à Rome, et il obtient le grand prix de Rome d’architecture. C’est là que son projet de Fourvière prend forme. À partir de 1852, il bâtit de nombreuses églises, chapelles et maison particulière. Il dessine aussi toute sorte de statues, de mobilier, d’orfèvreries. Lorsqu’en 1871 est prise la décision de bâtir la basilique Notre-Dame de Fourvière, à la suite de la préservation de la ville de Lyon de l’invasion prussienne, Bossan est fort de ses réalisations en particulier les sites de pèlerinage d’Ars (église Sainte-Philomène, début de construction en 1862) et de Lalouvesc (début de construction en 1864, ouverture au public en 1871).
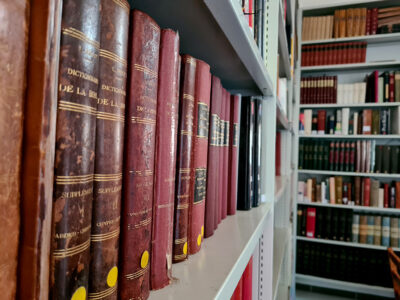 Il peut présenter son « vieux » projet de basilique. Celui-ci est accepté et la construction commence dès 1872. Très vite, Bossan, vieillissant et malade, se retire à La Ciotat, d’où il contrôle Sainte-Marie Perrin, à qui la construction a été confiée. Dans sa retraite, Bossan continue à dessiner, et en particulier la statuaire et le mobilier de sa grande œuvre de Fourvière. Auprès de lui se forme un certain nombre d’architecte, dessinateurs, sculpteurs et peintres.
Il peut présenter son « vieux » projet de basilique. Celui-ci est accepté et la construction commence dès 1872. Très vite, Bossan, vieillissant et malade, se retire à La Ciotat, d’où il contrôle Sainte-Marie Perrin, à qui la construction a été confiée. Dans sa retraite, Bossan continue à dessiner, et en particulier la statuaire et le mobilier de sa grande œuvre de Fourvière. Auprès de lui se forme un certain nombre d’architecte, dessinateurs, sculpteurs et peintres.
Il meurt en 1888 à La Ciotat, à l’âge de 74 ans. Pierre Bossan est enterré au cimetière de Loyasse, à quelques mètres de son œuvre.


